Fasciné très tôt par la vie sociale des abeilles dites domestiques Apis mellifera — en particulier lorsqu’elles vivent à l’état sauvage — , Thomas Seeley travaille à l’Université Cornell dans l’État de New York comme professeur de neurobiologie et de comportement animal. Ses travaux, qui ont permis de mieux connaître et comprendre le comportement social, la biologie et les stratégies de survie des colonies d’abeilles mellifères sauvages, sont porteurs d’espoir sur leur capacité à s’adapter et à se maintenir en bonne santé. Thomas Seeley a étudié et démontré comment ces colonies sauvages ont développé de nombreux comportements nouveaux et sont devenues résistantes au varroa. C’est ce qu’il nous explique dans cet entretien dont la version filmée est à retrouver dans les bonus du film Être avec les abeilles.
Perrine Bertrand : Vous êtes l’un des rares chercheurs au monde travaillant sur les abeilles sauvages ?
Thomas Seeley : Oui, je travaille sur les abeilles mellifères qui vivent à l’état sauvage en milieu forestier. Je suis professeur à l’Université de Cornell dans l’État de New York aux États-Unis et cela fait quarante ans que j’étudie les abeilles. Je suis fasciné non pas par les abeilles qui vivent dans des « boîtes carrées en bois » mais par les colonies d’abeilles qui évoluent dans la nature, dans la forêt. Il se trouve que ces populations ont finalement été très peu été étudiées.
Il est important de comprendre comment les abeilles vivent et se développent dans la nature, par elles-mêmes. En prétendant s’occuper et prendre soin des abeilles, les apiculteurs — et moi compris — multiplions les interventions. Or, à l’observation des colonies à l’état sauvage, on réalise que les conditions de vie que nous créons en les exploitant viennent s’opposer, à bien des égards, à ce qui existe naturellement, sans interférence humaine.
Finalement, en étudiant les abeilles à l’état sauvage, nous pouvons constater ce que nous « dé-faisons » lorsque nous pratiquons l’apiculture, c’est-à-dire quelle partie de leur biologie naturelle nous « annulons ».
PB : Y a-t-il toujours beaucoup d’abeilles sauvages ?
TS : Oui. Il y a beaucoup de colonies sauvages qui vivent par elles-mêmes, dans des zones forestières et même dans d’autres zones, souvent dans des arbres creux ou dans des crevasses rocheuses. Je travaille dans la forêt d’Arnot (Arnot Forest) qui couvre plusieurs centaines de kilomètres carrés et dans laquelle il y a une colonie par kilomètre carré. J’ai commencé à étudier ces populations d’abeilles sauvages dans les années soixante-dix, et force est de constater qu’elles sont restées stables au fil du temps.
PB : Ces abeilles sont-elles confrontées aux mêmes problématiques que les autres colonies domestiques ?
TS : Les colonies que j’étudie dans la forêt d’Arnot sont toutes infestées par l’acarien varroa qui est un parasite vivant sur les abeilles et propageant des virus qui les affaiblissent fortement. Toutefois, ces abeilles sauvages parasitées par le varroa et atteintes par ces virus n’en souffrent pas car elles sont capables de maintenir ce dernier à un niveau suffisamment bas. Autrement dit, elles ont évolué pour coexister avec le varroa. Grâce à la sélection naturelle, ces abeilles sont devenues résistantes à ce terrible parasite.


PB : Comment sont-elles devenues résistantes au varroa ? Comment coexistent-elles avec ce dernier ?
TS : Il faut considérer, d’une part leur génétique, et d’autre part leurs modes de vie et comportements. En étant soumise à la sélection naturelle, leur génétique a évolué. Certains comportements de protection se sont très bien développés, tels que le toilettage des varroas sur leur corps et leur capacité à mordre les pattes de ces acariens. Elles ont également appris à désoperculer les alvéoles du couvain où se trouvent les larves puis à les refermer afin de combattre la reproduction du varroa. Ces nouveaux comportements se sont inscrits dans leurs gênes et leurs ont permis de devenir résistantes aux acariens.
Mais il y a d’autres particularités qui les rendent résistantes : celles liées à leur mode de vie. Elles vivent dans des arbres creux et le volume offert par ces cavités pour construire leur nid est plus petit que celui d’une ruche d’apiculteur. Leur nid représente habituellement le quart ou le tiers de la dimension d’une ruche. Ce facteur a une incidence importante sur la biologie d’une colonie : cette dernière reste petite. Ainsi, les abeilles sauvages ont tendance à essaimer davantage. L’essaimage, c’est lorsqu’une colonie d’abeilles mellifères grossit à tel point qu’elle finit par remplir toute la cavité. La colonie devenant trop imposante et les abeilles trop nombreuses, elles se séparent. La vieille reine part avec environ les deux tiers des ouvrières, et une jeune reine prend le relais dans la colonie d’origine avec le tiers restant des ouvrières. Quand une colonie essaime, cela élimine une multitude d’acariens puisqu’ils partent avec l’essaim.
Un autre phénomène se produit quand il y a essaimage : cela crée une période durant laquelle il n’y a pas de couvain operculé dans le nid. Or, considérant que pour se reproduire le varroa a besoin d’avoir du couvain scellé et operculé, sa reproduction cesse durant l’essaimage et jusqu’à la reprise de la ponte.
Par ailleurs, quand les abeilles vivent à l’état sauvage dans une petite cavité, elles n’ont jamais autant de couvain que dans une ruche d’apiculteur. C’est particulièrement vrai à la fin de l’été, quand la colonie a rempli de miel toute la cavité. Les espaces vides sont occupés par le couvain mais avec des larves devenant de plus en plus petites. De fait, les acariens ont beaucoup moins d’opportunités pour se reproduire ; alors que dans les ruches d’apiculteurs à la fin de l’été, il y a beaucoup d’espaces que les abeilles remplissent entièrement de couvains.
C’est vraiment différent pour les abeilles de vivre dans la nature — au sein d’une petite colonie qui essaime et ne fait pas de surplus de miel pour l’apiculteur — ou au contraire de vivre dans une grande ruche avec beaucoup de couvain sans essaimage et produisant beaucoup de miel.

PB : Vous avez parlé de génétique : le varroa n’était pas présent en Europe il y a quelques années, et pourtant en quelque temps les abeilles ont été capables de s’adapter ?
TS : Oui, nous avons découvert qu’il leur a fallu environ huit ans pour devenir résistantes. Dans d’autres travaux, des conclusions similaires ont été constatées en Suède. Disons que sur une période comprise entre quatre et dix ans, les différentes populations sont capables d’évoluer et de devenir résistantes à l’acarien, ce qui s’explique par le processus de sélection naturelle. Les colonies qui ne possèdent pas les aptitudes pour résister au varroa meurent, tandis que celles qui les ont, résistent et conservent leurs populations vivantes.Nous avons pu démontrer que le varroa est arrivé aux États-Unis dans l’État de New York et a atteint les colonies sauvages que j’étudie, autour de 1993. Et en étudiant la génétique, nous savons qu’il y a eu une période durant laquelle le nombre de colonies a baissé. Néanmoins, quand j’ai recensé à nouveau le nombre des colonies en 2002, nous étions revenus au même niveau qu’avant l’arrivée du varroa. Je suis donc en mesure d’affirmer qu’entre 1993 et 2002, ces populations d’abeilles sauvages ont acquis la résistance au parasite varroa.
PB : Vous avez pu observer cela sur l’ensemble des colonies étudiées ?
TS : Tout à fait, oui. La sélection naturelle est un phénomène que l’on peut percevoir et appréhender à grande échelle. Vous devez étudier une large population de colonies pour pouvoir faire des observations valables.
PB : Comment les colonies d’abeilles résistent-elles aux autres problèmes ?
TS : Dans cette forêt, les abeilles sont confrontées aux ours noirs, qui malgré leur odorat fort développé, ont une faible acuité visuelle. Aussi, pour se protéger, les abeilles s’installent très haut dans les arbres, parfois à plus de trente mètres de hauteur. L’entrée du nid est un trou d’environ cinq centimètres de diamètre qui se trouve toujours à dix mètres de hauteur minimum. De cette façon, les ours noirs ne parviennent pas à les voir correctement. J’ai pris conscience que le critère de hauteur était primordial lorsqu’un jour d’hiver, l’arbre qui abritait une des colonies que j’étudiais, avait été couché par le vent. En tombant, l’arbre n’avait pas tué la colonie, mais l’entrée du nid s’était soudainement retrouvée à même le sol. Un ours qui passait par là avait essayé de décortiquer l’arbre à grands coups de griffes. Cela dit, les abeilles avaient survécu car elles avaient été protégées par l’arbre. Derrière cette anecdote, ce qui est intéressant à retenir, c’est que les abeilles, qui avaient été protégées durant des années du fait de la hauteur de leur habitat, devenaient soudainement vulnérables parce que l’entrée de leur nid était au ras du sol
PB : Qu’est-ce qui différencie les abeilles sauvages des abeilles domestiques ?
TS : Nous avons fait des comparaisons au niveau génétique avec des abeilles qui vivent dans des ruches proches — à environ une dizaine de kilomètres de cette forêt — et nous avons constaté que les colonies sauvages sont génétiquement différentes des colonies domestiques. Les abeilles qui vivent dans la nature ont été exposées à la sélection naturelle, et sont donc bien adaptées pour vivre dans cette partie du monde. Quant aux abeilles domestiques, elles sont bien souvent issues de colonies ou de reines élevées et produites artificiellement. Elles viennent de Californie ou de Floride, des régions dans lesquelles le climat est beaucoup plus doux ; alors que les abeilles qui vivent dans cette forêt ont dû survivre à des hivers froids, des étés chauds et se débrouiller seules, sans aucune aide humaine. Et elles s’en sortent très bien !
La mortalité annuelle est d’environ 15 %, mais elles se reproduisent et les populations restent stables. Il y a toujours une colonie par kilomètre carré. J’ai effectué des mesures à trois reprises : en 1978, en 2002, en 2010, et la densité des colonies est restée la même.

PB : Quelle est la mortalité dans les ruches domestiques implantées dans la même zone ?
TS : Il y a moins de perte chez les apiculteurs : environ 5 %. Dans la nature, les colonies ont une vie plus dure. Il n’y a personne pour les aider. Par exemple, si elle n’a pas assez de réserve de miel au printemps, la colonie risque fort de mourir, contrairement à celle d’un rucher pour laquelle l’apiculteur peut pallier la disette par le nourrissement en miel ou en eau sucrée.
PB : En France, les apiculteurs perdent beaucoup d’abeilles, parfois 50% et jusqu’à 100% de leurs ruches. Vous n’êtes pas confrontés à ce problème aux USA ?
TS : Aux États-Unis, les apiculteurs professionnels pratiquant la transhumance perdent environ 50 % de leurs colonies chaque année. Ils prennent les abeilles dans l’État de New York pour les amener polliniser les amandiers en Californie. Ces colonies ne sont pas en bonne santé. Un apiculteur qui ne fait pas de transhumance, qui laisse les abeilles à un seul endroit comme dans l’État de New York et qui ne les déplace pas, peut s’attendre à une mortalité d’environ 10 %, ce qui est considéré comme acceptable.
PB : Que pouvez-vous conseiller à un apiculteur pour avoir des abeilles saines ?
TS : Pour conserver des abeilles saines, un apiculteur doit contrôler la présence de varroas dans ses ruches. Cela représente un réel défi dans la mesure où une colonie hébergée par un apiculteur est une colonie très grosse, qui vit souvent dans une grande ruche avec beaucoup de couvain, lequel est un hôte parfait pour le varroa. Les apiculteurs traitent habituellement les colonies avec des produits chimiques, des poisons anti-acariens appelés acaricides. Ces traitements sont présentés comme nécessaires pour garder un niveau d’acariens bas. Un niveau trop élevé de varroas entraînant des infections plus importantes, les abeilles seront alors trop faibles pour survivre aux hivers froids.
Je vis dans une zone où les fleurs sauvages sont nombreuses, mais les apiculteurs du Middle West des États-Unis sont confrontés à un problème supplémentaire : la recherche d’une nourriture de qualité pour leurs abeilles. Auparavant, le Middle West offrait d’importantes ressources mellifères avec des cultures fourragères, des prairies riches en trèfle, mais, désormais, avec le développement de l’agriculture intensive, de nombreux agriculteurs ont découvert qu’il était plus profitable de faire pousser du maïs et du soja, céréales qui ne fournissent malheureusement pas de nourriture aux abeilles à miel.
PB : Est-ce que l’adaptation au varroa est possible pour des abeilles dans des ruches ?
TS : Bien sûr, cela est possible, y compris dans une colonie « gérée » et « domestiquée », à condition de les laisser faire, de ne pas les traiter et d’accepter l’expérience de la sélection naturelle.
Les apiculteurs refusent de prendre cette voie-là parce que si vous avez une centaine de ruches et que vous ne les traitez pas, vous allez perdre 90 % de vos colonies. Cela ne va pas se produire sur une année mais sur deux ou trois ans. Ainsi, le nombre de vos colonies va passer de cent à dix. Toutefois, ces dix colonies qui vont rester vivantes seront devenues résistantes au varroa et vous pourrez alors reconstruire votre rucher à partir de cette base-là. Mais il est certain que rester sans revenu durant deux ou trois ans est compliqué, voire inenvisageable pour certains, en particulier sans aide extérieure.
Je pense que c’est l’un des défis de ce monde : comment peut-on être apiculteur professionnel et s’occuper de très grandes colonies, très productives, et en même temps avoir des abeilles résistantes aux varroas ? Nous savons comment les abeilles font dans la nature, mais c’est une énigme de savoir comment elles peuvent survivre dans le contexte d’exploitation inhérent à l’activité apicole de production. Cela dit, je suis assez optimiste et je pense que les abeilles seront capables de relever ce défi.

PB : Que pensez-vous des abeilles noires et locales ? Des conservatoires d’abeilles locales ?
TS : La conservation de ces abeilles est une excellente chose. De très nombreuses études révèlent que les organismes se sont adaptés au climat local et aux différentes conditions de vie. Historiquement, c’est ce que les abeilles ont fait. En Angleterre, il existe des races d’abeilles qui se sont adaptées au climat d’une vallée ou de régions situées le long de la côte. Nous les avons perdues pour la plupart, car maintenant les apiculteurs déplacent les colonies et les reines. Aujourd’hui par exemple, beaucoup de reines provenant d’Italie sont envoyées en Angleterre ou en Écosse ; or, ces abeilles sont adaptées au climat de la région d’où elles proviennent en Italie mais sûrement pas au climat anglais, galois ou écossais ! L’adaptation des abeilles au milieu a été démontrée par de nombreux travaux, notamment dans une étude française. Un bel échange a été effectué entre des colonies d’abeilles du Sud-Ouest de la France et des colonies issues de la région parisienne. Les abeilles de Paris se développaient rapidement au printemps avec une forte croissance du couvain alors que celles du Sud-Ouest avaient un rythme plus lent au printemps mais un pic d’élevage de couvain au mois d’août, période durant laquelle les abeilles de Paris commençaient à décroître. C’est parce que dans le Sud Ouest, le cycle de croissance de la colonie s’était construit autour de la floraison de la bruyère tandis que celui des abeilles parisiennes, sur la floraison du printemps. Un exemple classique de l’adaptation locale !
PB : Ces abeilles sont aujourd’hui métissées avec d’autre abeilles italiennes par exemple, il n’ y a quasiment plus d’abeilles noires « pures » ?
TS : Oui c’est vrai. Néanmoins, il faut peu de temps aux abeilles pour reconstruire cette adaptation locale : dix ans environ. Si le processus est respecté, la sélection naturelle fonctionne toujours. Sans intervention humaine sur la sélection naturelle, il ne faut pas plus d’une dizaine d’années pour avoir une lignée d’abeilles très bien adaptées au nouveau climat.
PB : Elles s’adaptent également aux rigeurs du climat, aux hivers froids ?
TS : Oui, les abeilles doivent s’adapter aux conditions hivernales — à la longueur et à la sévérité de l’hiver —, mais également à la saisonnalité des fleurs qui représentent leurs ressources alimentaires. Il s’agit pour elles de faire ainsi coïncider période de reproduction et de croissance et abondance de nourriture.
PB : C’est un autre problème si les abeilles n’ont pas assez de nourriture… n’est-ce pas plus difficile pour elles de s’adapter ?
TS : Les besoins des abeilles sont assez simples : elles ont besoin d’eau, de nectar et de pollen. Mais élever de nombreuses abeilles exige beaucoup de pollen. Aussi, elles doivent ajuster leur production de couvains à la période pollinique.

PB : Dernière question. Pendant toutes ces années à observer les abeilles, qu’avez-vous appris d’elles ?
TS : C’est une question si vaste qu’il est difficile de lui donner une réponse en quelques mots : j’ai appris tellement de choses de ces créatures merveilleusement bien adaptées ! Mais la leçon la plus importante est peut-être de se rappeler que les abeilles mellifères sont d’excellentes apicultrices et probablement bien meilleures que ne le sont les humains !
—
Interview menée par Perrine Bertrand à retrouver dans le quatorzième numéro de la revue Abeilles en liberté.
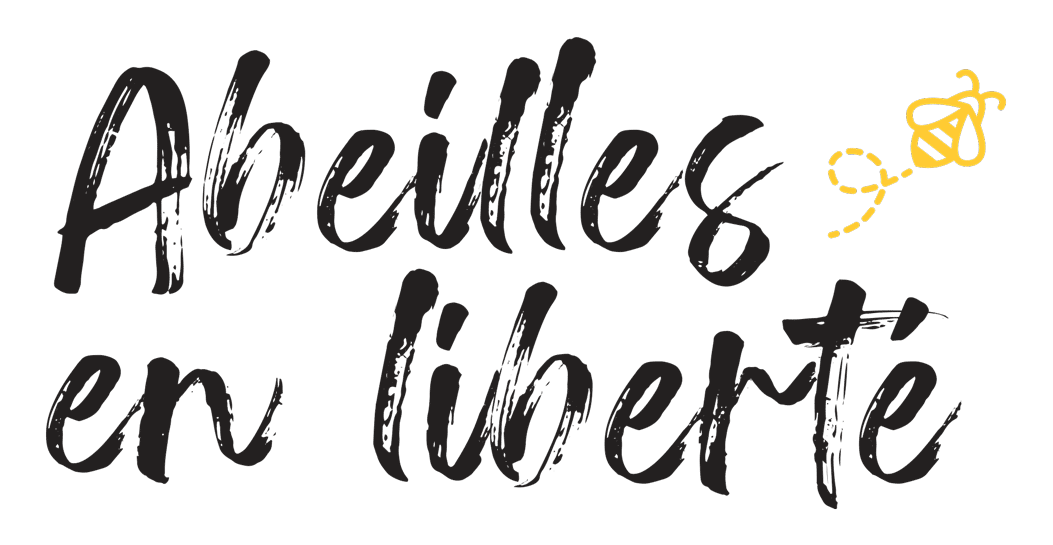






Bonjour,
Je vis actuellement en Suisse. Une association, que Ael mentionne dans certains de ses numéros, a commencé depuis un certain temps la recherche et le suivi de telles colonies. Il s’agit de freethebees.ch. Vous trouverez plein de renseignements qui vous intéresseront peut-être !
Anne
Bonjour,
J’ai lu cet article avec beaucoup d’intérêt.
Je me pose la question suivante : quel est en Europe le pourcentage de nos essains d’abeilles ( non récupérés pour être mis en ruchette par un apiculteur ) qui survivent et retournent à l’état sauvage ? Il y en a certainement ! Existe t’il une telle observation ..? Je vais me renseigner. Si ce n’est pas le cas, je suis preneur pour réaliser ce Job !
Apicalement, Emmanuel Gilson +32475377377
Mail: emmanuelgilson@gmail.com
Bonjour Emmanuel, merci pour votre intérêt et pour ces retours.
L’un des meilleurs connaisseurs de ce sujet en France est Vincent Albouy, je ne suis pas sûr qu’il ai accumulé assez de données pour répondre précisément, mais des études en ce sens existent. Pour information Ael publiera dans son 16e numéro un « Suivi comparatif sur les abeilles mellifères sauvages de trois régions d’Europe de l’Ouest (Ouest de la France, Luxembourg, Dortmund) », article co-écrit par Vincent Albouy. Voici son contact si besoin (de la part de la revue Ael) : opiepc@orange.fr
Bien cordialement.