Des faux bourdons, en proportion élevée par rapport aux ouvrières, volent alentour de la ruche ou se déplacent autour de son entrée. Certaines ouvrières continuent leurs allées et venues, parfois chargées de pollen, mais beaucoup semblent agitées, voire paniquées…

Cette photographie ci-dessus n’est pas suffisante pour conclure qu’une colonie est bourdonneuse et pourrait ne rien signaler d’alarmant. Toutefois elle montre le type d’abeilles que l’on observe alors en surnombre dans cette configuration-là : les mâles. Une colonie de ce type peut également produire un bruit inhabituel — un peu sourd —, et les ouvrières qui poursuivent leurs tâches de butinage apparaissent le plus souvent agitées et particulièrement stressées.
Cet état de panique est justifié puisque la colonie a perdu sa reine au mauvais moment. Une colonie d’abeilles n’est viable que si elle parvient à maintenir l’équilibre dans sa population : s’il est fragilisé, la résistance et l’adaptation de la colonie entrent en jeu. Mais, à moins d’une intervention humaine, il n’y a plus rien à espérer de la résistance naturelle d’une colonie qui, orpheline, est condamnée. Que s’est-il passé ?
- Après essaimage, une jeune reine vierge n’est pas revenue à sa ruche après son vol d’accouplement. Elle a pu être dévorée par un oiseau ou par un autre prédateur comme le frelon.
- Une vieille reine, ou une reine malade, meurt durant l’hiver. Le problème vient du fait que le couvain est en trop faible quantité mais surtout que les très jeunes larves destinées à l’élevage royal en sont absentes. Quand bien même une jeune reine aurait-elle pu émerger, elle serait condamnée à demeurer vierge, faute de faux bourdons en cette période hivernale.
Lorsqu’une colonie perd se reine, elle constitue ce que nous nommons une « colonie orpheline ». Si cette colonie survit jusqu’au tout début du printemps, elle ne pourra espérer entreprendre le moindre renouvellement de reine : à l’intérieur du nid, la chambre à couvain reste vide d’avenir.
En temps normal, lorsque la saison redémarre et que les fleurs reviennent, les abeilles éprouvent le besoin irrépressible de combler les cellules de miel et de pollen. Or dans cette colonie il n’en est rien : les abeilles stressent, s’agitent… Certaines d’entre elles peuvent alors retrouver la fonctionnalité de leur organe reproducteur dont le développe ment était inhibé par les phéromones royales. Pour autant ces ouvrières devenues des pseudo-reines, ne peuvent pondre que des œufs non fécondés, c’est à-dire des œufs de mâles. Ainsi, sans renouvellement, la colonie s’appauvrit en ouvrières et seuls des mâles subsistent, condamnés.
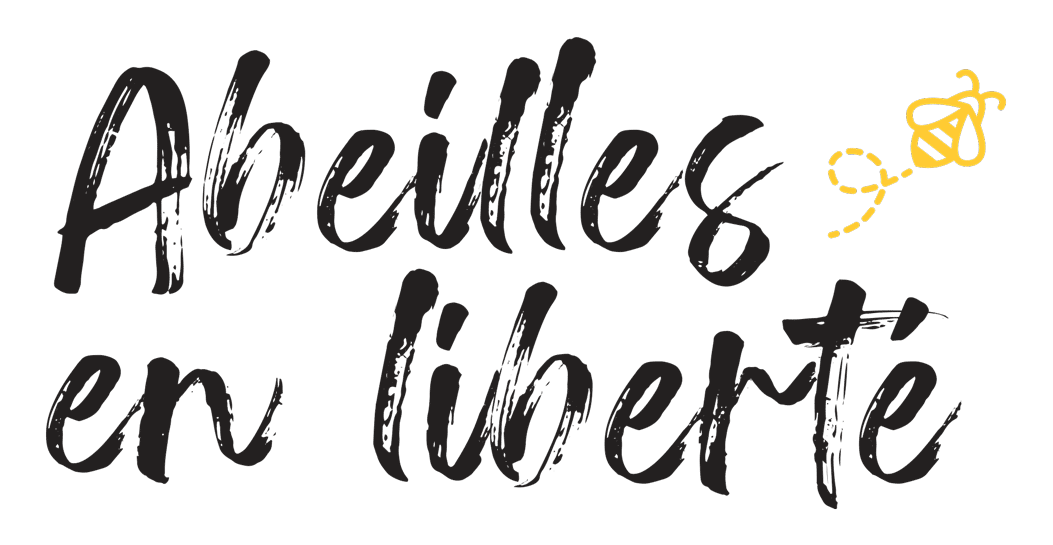

Bonjour Jacky Sarday,
Merci pour ce commentaire. Bien que je comprenne mal s’il s’agit d’une question ou d’une observation!
Je peux tenter quelques réponses en fonction de ce que je distingue dans votre commentaire:
Les mâles sont issus de la ponte d’œufs « non-fécondés » issu soit de la reine, soit d’ouvrières pondeuses.
– De la reine fécondée:
Pour fournir dans la population d’une colonie un ratio de mâles susceptibles de participer à la fécondation de reines vierges issues des populations locales alentours.
– Ouvrières pondeuses:
Cas de parthénogenèse (Ponte d’œufs non fécondés). Suite à l’impossibilité d’avoir un couvain d’ouvrières (disparition de la reine, jeune reine dont la fécondation est impossible…blessure…etc), des ouvrières (Et non « des ouvriers ») qui ne peuvent êtres fécondées se mettent à pondre des œufs non fécondés, donc des œufs de mâles. La colonie n’a guère de chance d’avenir dans ce cas là. Les mâles issus d’une colonie dite « bourdonneuse » sont tout aussi aptes à la reproduction que n’importe quels autres mâles issus d’élevage de reine.
Henri Giorgi
Les ouvriers pondent les faux bourdon dans les cellule d’ouvrière reconnaissable operculation débordante, issus d’ouvrières pondeuses ils sont vulgairement appelés mulet mais sont tout à fait viable pour la reproduction